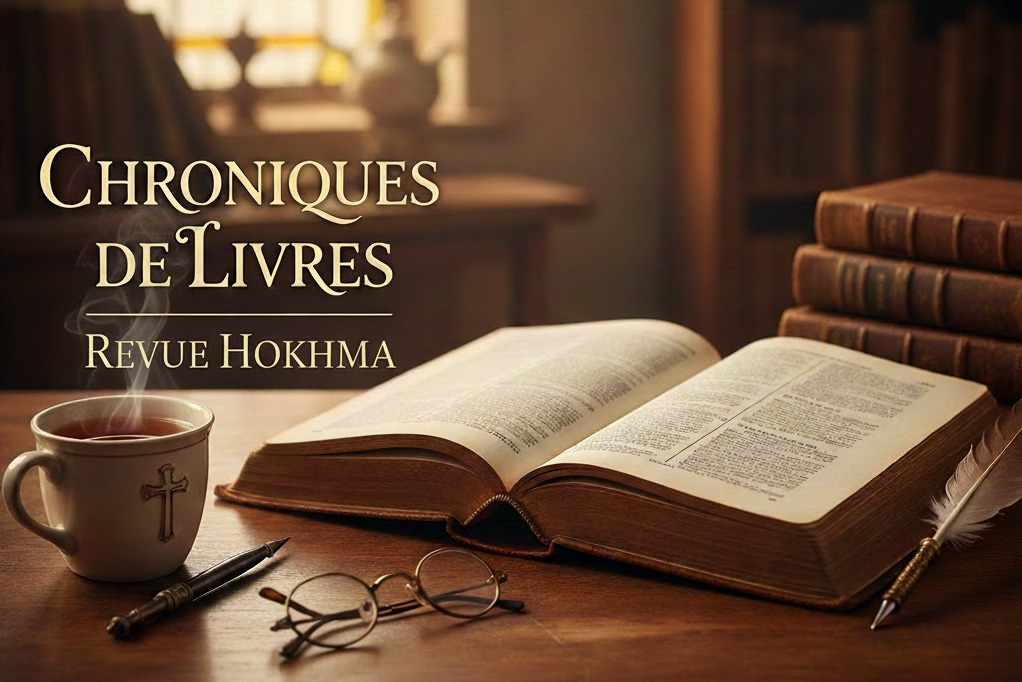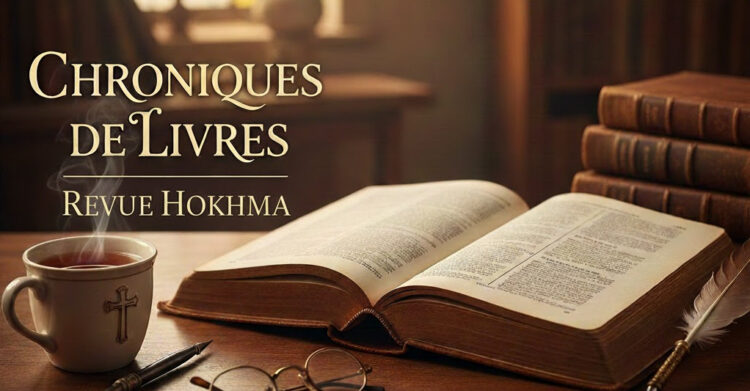Gérard Pella, 7 semaines pour nous ouvrir au Saint-Esprit
Jean Decorvet, Tim Grass et Kenneth J. Stewart (dir.), Le Réveil de Genève. Perspectives internationales
Mark A. Noll, Jésus-Christ et le développement de la vie intellectuelle
Michel Siegrist (sous dir.), Découvrir la foi avec les enfants – questions théologiques et pratiques
Flavius Josèphe, Œuvres complètes
Charles Kouyoumdjian, Séniors porteurs de fruits. La vie chrétienne ne s’arrête pas à 60 ans !
Frédéric Worms, La vie, qu’est-ce que ça change ?
Glenna Marshall, Mémoriser l’Écriture. Acquérir les bases et découvrir les bénédictions de la Bible
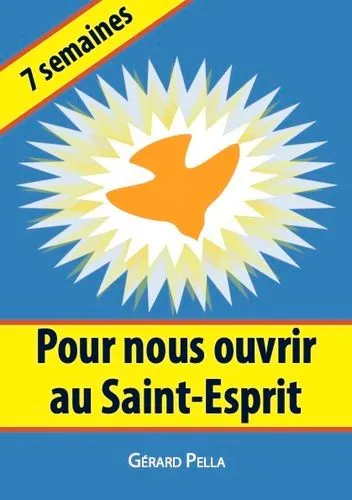
Gérard Pella, 7 semaines pour nous ouvrir au Saint-Esprit – édité par l’auteur, diffusion en Suisse : La Maison de la Bible, diffusion en France : La Cause – ISBN : 978-2-8399-4623-0 – 10 € ou CHF 10.
Gérard Pella est bien connu des lecteurs de Hokhma, revue qu’il a contribué à créer en 1976 et dont il a fait partie du comité de rédaction pendant des décennies. Pasteur de l’Église Évangélique Réformée du Canton de Vaud, il a toujours cherché à donner à la vie des paroisses où il a œuvré, une dimension marquée par le Saint-Esprit. C’est ainsi que, partant du travail effectué par des prédécesseurs, il a élaboré un programme de sept semaines visant à donner à chacun les bases solides sur lesquelles édifier une vie chrétienne épanouie, remplie et dirigée par le Saint-Esprit. Il a été amené par la suite à répondre à diverses demandes pour donner cet enseignement dans divers milieux ecclésiastiques, puis finalement à le rendre accessible à un plus large public en le mettant par écrit.
Le livre que nous présentons ici servira aussi bien de manuel pour les responsables qui auront à cœur d’organiser et d’animer ce parcours des 7 semaines dans leur communauté (paroisse, groupe de prière, etc.) que de support aux participants qui suivront ce programme.
Dans les dix chapitres de ce livre, on trouvera tout ce qui est nécessaire pour animer et vivre ce cheminement des 7 semaines : des directives pratiques avec le programme type des rencontres, le contenu de chacune d’elle qui permettra de progresser dans la démarche. On y trouvera aussi des questions à discuter en groupe et des versets bibliques à méditer pendant la semaine.
La démarche part du constat que chaque humain « a soif » d’une vie pleine et épanouie, qu’il soit chrétien ou pas. Jésus veut y répondre par le don du Saint-Esprit (Jn 7,37-39). Les semaines suivantes permettent au participant de s’assurer que les bases indispensables à la poursuite de la démarche sont bien posées : a-t-il une image faussée de Dieu ? le salut de Dieu avec ses différentes facettes est-il une réalité dans toute sa vie ? Jésus est-il son Seigneur ? est-il réconcilié avec Dieu ? a-t-il apporté à Dieu ses blessures et tout ce qui l’empêche d’être en communion avec lui ? Ces bases posées, l’œuvre du Saint-Esprit est présentée, tant au niveau individuel qu’ecclésial : on y trouvera une brève présentation du renouveau charismatique, des témoignages divers ainsi que la démarche à mettre en œuvre pour être rempli du Saint-Esprit et que l’Évangile puisse rayonner tant par le témoignage individuel que communautaire.
Ce livre est accessible à tous. Des images aident à retenir et intérioriser les enseignements donnés. Par exemple :
– le couteau suisse avec ses multiples fonctions, illustre les diverses facettes de l’œuvre du salut ;
– pour savoir si Jésus est le Seigneur de sa vie, le participant est invité à se demander s’il est au volant ou dans le coffre de sa voiture ?
Souhaitons que ce livre soit largement connu et diffusé pour que la vie de l’Église de Jésus soit dynamisée.
Alain Décoppet
Jean Decorvet, Tim Grass et Kenneth J. Stewart (dir.), Le Réveil de Genève. Perspectives internationales, Saint-Légier 2024, HET-PRO – ISBN : 978-2-940650-12-5 – 592 pages – CHF 25 ou 25 €.
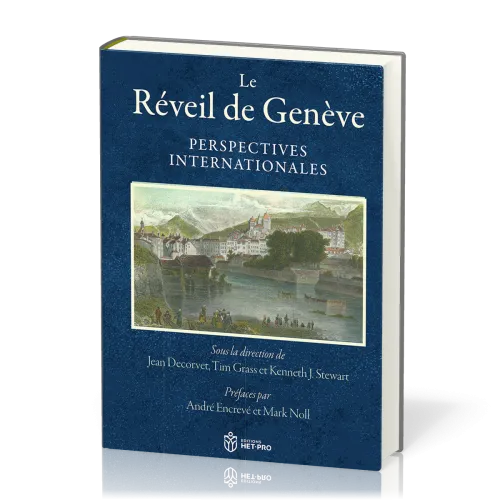
Cet ouvrage collectif édité par Jean Decorvet inscrit le Réveil de Genève du début du XIXe siècle dans le tissu relationnel local et international qui l’a accompagné dès ses origines et tout au long de son développement. Un incontournable accessible aux non-initiés et riche en découvertes pour ceux qui connaissent l’histoire de ce mouvement qui a profondément modifié le paysage du protestantisme francophone.
« Ce livre nous offre un festin ! » Voilà en substance ce que le fameux historien du mouvement évangélique, l’Étasunien Mark A. Noll, déclare dans la préface du livre collectif : Le Réveil de Genève. Perspectives internationales. Il y a là festin tout d’abord pour celui qui ne connaît pas les origines du mouvement évangélique en Suisse romande. Cette publication de plusieurs spécialistes, éditée notamment par Jean Decorvet, recteur de la HET-PRO à Saint-Légier, est l’occasion de découvrir l’histoire d’un mouvement de renouveau de la foi, qui débute dans les premières années du XIXe siècle à Genève, avec des figures de proue comme Robert Haldane, Félix Neff ou Louis Gaussen.
Ce livre est aussi « un festin » pour celui qui en sait davantage sur le Réveil à l’origine de l’Église libre de Genève, des Églises de la FREE et de plusieurs familles d’Églises libres en Suisse comme en France. Grâce à l’inscription de ce mouvement dans sa dimension internationale, ce livre permet de prendre conscience de ses nombreux liens avec le Royaume-Uni, les États-Unis, le monde germanique, les Pays-Bas… et bien entendu la France ! Le Réveil de Genève pose donc un regard beaucoup plus large – international – sur un phénomène local où nombre de lieux chargés d’histoire se trouvent en vieille-ville de Genève.
Un réveil en deux vagues
Dans une introduction générale, Jean Decorvet montre comment le Réveil de Genève a transformé le paysage protestant francophone. Au travers de deux vagues successives, le Premier Réveil (1810-1818) et le Second Réveil (1830-1832), de jeunes étudiants en théologie et de jeunes pasteurs genevois découvrent Jésus-Christ au travers d’une expérience spirituelle personnelle. Dans la foulée, ils s’enracinent dans la pensée du réformateur du XVIe siècle Jean Calvin, en un temps où l’Église protestante de Genève était marquée par le « déisme » plutôt que par une pensée trinitaire. Pour faire court : par des vues libérales, plutôt que par un christianisme orthodoxe.
Cette double revitalisation spirituelle et calvinienne va entraîner un autre rapport à l’État et à la société. Certains « réveillés » vont créer des Églises indépendantes de l’État, une nouveauté à l’époque en terreau protestant romand, du point de vue du pluralisme religieux. Ces communautés seront les ancêtres de l’Église libre de Genève et, via l’Église évangélique de la Pélisserie, des Églises de la FREE. D’autres « réveillés » comme César Malan vont créer des communautés qui s’affilieront à des Églises réformées à l’étranger, plus orthodoxes que l’Église réformée de Genève. Et d’autres, comme Louis Gaussen ou Frédéric Monod, tenteront de rester dans leur Église réformée pour œuvrer de l’intérieur à leur renouveau.
Un réveil populaire, puis plus aristocratique
Mû par cette découverte de la joie du salut en Jésus-Christ, le Premier Réveil éclot en milieu populaire, alors que le Second Réveil touchera une population plus aristocratique, avec des personnalités comme le théologien Louis Gaussen ou Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Cette seconde vague donnera une assise intellectuelle au mouvement, notamment au travers de la fondation en 1831 de l’École de théologie qui s’installera bientôt sur le site de la chapelle de l’Oratoire, en vieille ville de Genève.
Comme le souligne Jean Decorvet : « En bénéficiant de contacts abondants avec des missionnaires britanniques, nord-américains et allemands à divers stades de son développement, le Réveil s’est inscrit dans l’« Internationale évangélique » qu’il contribua à façonner et à influencer par le biais de ses propres activités littéraires, missionnaires et philanthropiques ».
Dans la deuxième partie de ce festin, Le Réveil de Genève. Perspectives internationales nous emmène à la découverte de la diffusion de ce mouvement en France, dans le canton de Vaud, dans les régions germanophones, aux Pays-Bas, en terres anglophones, en Italie et au Canada.
Au travers de divers contributeurs, la troisième partie de ce livre se penche sur des « Figures majeures du Réveil » : Adolphe Monod, Frédéric Monod, César Malan, Félix Neff ou Louis Gaussen, notamment.
Diffusion et impact
Grâce à des contributions de Monique Cuany, professeur d’histoire à la HET-PRO, et de Sarah Scholl, professeur associée d’histoire du christianisme à l’Université de Genève, la quatrième partie du livre Le Réveil de Genève va traiter entre autres du sujet « Le Réveil et les œuvres. Éducation, soins et société » et du thème : « Réveil et catholicisme ». Dans sa contribution, Monique Cuany souligne la multiplication dans la foulée du Réveil de Genève des œuvres ou sociétés charitables et philanthropiques à Genève et dans le monde francophone. Parmi les plus marquantes, elle en présente deux : les diaconnesses de Reuilly et de Saint-Loup ainsi que la Croix-Rouge fondée par Henri Dunant et Gustave Moynier.
De son côté, Sarah Scholl montre que le Réveil se nourrit dans ses débuts d’une fascination pour le catholicisme à cause de sa doctrine et de son rituel, et plus tard d’un anticatholicisme qui remonte à la Réforme du XVIe siècle. Néanmoins des causes communes comme la défense de la liberté religieuse et la défense du dimanche comme jour chômé a posé les bases d’un « proto-œcuménisme ».
« Cet ouvrage est un commencement »
Par ses prestigieux contributeurs, Le Réveil de Genève. Perspectives internationales donne un nouveau crédit à ce renouveau très helvétique et à l’impact international qu’il a eu. Cet ouvrage de référence devrait ouvrir des perspectives à des recherches nouvelles, non seulement en milieu évangélique, mais beaucoup plus largement au plan académique. Ce qu’aucune publication en français de ces dernières décennies, aussi remarquables soient-elles, n’est parvenue à susciter.
« Plus qu’un aboutissement, cet ouvrage est un commencement », appuie Jean Decorvet dans son introduction générale. On se réjouit de poursuivre ce festin en découvrant de futurs travaux historiques et théologiques, qui pourraient ouvrir des pistes stimulantes non seulement pour approfondir la contribution évangélique au pluralisme religieux et à la liberté de conscience en Suisse… mais peut-être pour contribuer à la revitalisation de toutes nos Églises !
Serge Carrel
Mark A. Noll, Jésus-Christ et le développement de la vie intellectuelle – Saint-Légier 2024, Éditions HET-PRO – ISBN : 978-2-940650-24-8 – 248 pages – CHF 18.
Avec Jésus-Christ et le développement de la vie intellectuelle, Mark Noll engage une réflexion en faveur d’un dialogue fécond entre foi chrétienne et vie intellectuelle. Il y soutient que la doctrine de l’incarnation du Christ, mystère central du christianisme, offre un cadre épistémologique permettant de concilier foi et raison. Puisque Dieu lui-même a pris chair et qu’il est entré dans l’histoire, la matérialité du monde, de même que la condition humaine, sont dignes d’être étudiées avec la plus grande rigueur. Pour Mark Noll, la foi chrétienne n’entrave pas la raison, mais lui donne une direction et une profondeur, en stimulant un engagement intellectuel ouvert et rigoureux. Au fil des pages de ce livre, nous sommes donc tous invités à oser un cœur intelligent, non seulement pour comprendre ce qu’est l’espérance chrétienne, mais pour l’annoncer et la vivre.
(Quatrième page de couverture – Jean Decorvet)
Michel Siegrist (sous dir.), Découvrir la foi avec les enfants – questions théologiques et pratiques – Saint-Légier 2024, Coédition Ligue pour la Lecture de la Bible et HET-PRO – ISBN : 978-2-940650-23-1 – 192 pages – CHF 14.
L’évolution de notre société imposait de remettre sur le métier la question de la transmission de la foi aux enfants. Sous la direction de Michel Siegrist, professeur à la HET-PRO et ancien directeur de la Ligue pour la Lecture de la Bible en Suisse romande, Coline Aubry, Pascale Bittner, Alexis Bourgeois, Frédéric Hammann, Noémie Lacombe, Nathalie Perrot et Corinne Siegrist ont uni leurs compétences pour traiter les divers aspects de ce sujet capital pour la vie de l’Église.

Alain Décoppet
Flavius Josèphe, Œuvres complètes, édition établie et présentée par Mireille Hadas-Lebel, Paris 2022, Bouquins Éditions – ISBN 978-2-221-13298-2 – 1501 pages – 37 €.
Bien que cette édition remonte déjà à 2022 – sa parution m’avait alors échappé – il me semble important de la présenter étant donné l’utilité que les œuvres de Flavius Josèphe revêtent pour le bibliste : Josèphe (env. 37-100 apr. J.-C.) est souvent le seul témoin antique à nous parler des événements contemporains de Jésus et des Apôtres.
Sa Guerre des Juifs décrit dans le détail la révolte juive de 66 à 73 avec une présentation des circonstances qui ont déclenché cette guerre en remontant jusqu’à l’époque des Maccabées vers 170 av. J.-C.
Dans ses Antiquités juives, il raconte l’histoire d’Israël, en la présentant d’une manière accessible à un public gréco-romain.
Il est parfois le témoin d’interprétations midrashiques dont on retrouve des éléments dans la littérature rabbinique. Cela peut s’expliquer par ses ascendances sacerdotales dont il témoigne dans son Autobiographie.
Enfin, Contre Apion est une œuvre apologétique qui défend le judaïsme contre un critique du premier siècle qui l’avait dénigré.
Cette nouvelle édition permet d’accéder en un volume maniable, et pour un prix abordable, à l’ensemble de l’œuvre de Josèphe déjà publiée, mais en plusieurs volumes, souvent épuisés. Mireille Hadas-Lebel a repris, mis à jour et annoté des traductions existantes : celles de Reinach pour les Antiquités juives et la Guerre des Juifs, de Bachon pour l’Autobiographie et de Léon Blum pour Contre Apion. On y trouve la division en livres et sections de l’édition grecque de Niese avec celle en livres et chapitres (mais sans les sections) des éditions anglaises.
Grâce à cette édition, le lecteur pourra se replonger dans l’ambiance du Ier siècle de notre ère en Palestine et se référer aux nombreux renvois aux œuvres de Josèphe qu’on trouve dans les ouvrages d’étude biblique.
Alain Décoppet
Charles Kouyoumdjian, Séniors porteurs de fruits. La vie chrétienne ne s’arrête pas à 60 ans !, Charols, Excelsis, 2024, 115 pages.
Avec son titre évocateur et sa photo de couverture montrant une main saisissant une belle pomme rouge encore accrochée à sa branche porteuse, cet ouvrage annonce bien son sujet. Ce que confirment les premières pages, qui rendent compte d’une expérience sylvicole : sur un arbre vieillissant ont été pratiquées de multiples greffes. Cet arbre se met alors à produire une multitude de fruits variés, des pommes, des cerises, des abricots et d’autres dans un foisonnement improbable.
Les cinq chapitres qui composent ce livre d’édification s’attachent à développer sur différents plans l’image de ces troncs dont l’âge, loin d’être seulement un handicap, peut devenir une vertu remarquable et tout à fait originale.
Mais avant même l’originalité s’impose l’actualité qu’est la situation des séniors, dont le terme a émergé en même temps que sa réalité. Les séniors sont en effet une classe d’âge en plein essor avec le vieillissement de la population. Pour ne citer que deux chiffres : + 14 années d’espérance de vie pour les hommes depuis 1950 ; 30 000 centenaires en France en 2025, 75 000 peut-être en 2040 ; et un nombre de pré-retraités qui a été multiplié par 6 entre 2010 et 2021.
Au-delà de ce constat massif, qu’est-ce qu’un sénior ? Il est possible d’en donner une double définition. Du point de vue de la vie sociale, un sénior est une personne de 60-65 ans. C’est en général à partir de cet âge que certaines aides, comme des signes de reconnaissance, apparaissent. Du point de vue de la vie professionnelle, ce serait plutôt à partir de 45-50 ans. Dans l’un ou l’autre cas, nous touchons un nœud existentiel qui s’articule à la fin de la vie professionnelle, et qui peut coïncider avec des situations douloureuses : des périodes de chômage pour ceux qui sont toujours « trop » (trop âgés, trop diplômés, trop chers…), le deuil de toute une vie professionnelle, accompagné souvent de changements familiaux. Tout à coup, le tronc ne semble plus pouvoir bourgeonner., sinon de manière extrêmement réduite. Pourtant une fécondité reste possible, pour une production moins quantitative que qualitative.
Quelle autre figure biblique que celle d’Abraham, appelé à quitter ses anciennes habitudes à 75 ans, peut éclairer la situation des séniors par une perspective biblique ? Alors que le poids des années peut être synonyme d’immobilité, cette histoire les replace dans la perspective d’une marche, développée par l’auteur dans les 2e et 3e chapitres. Comment envisager ce départ d’Abraham, dont la radicalité peut impressionner, voire dissuader ? Pour rester avec cette image de l’arbre, s’agirait-il tout simplement d’un déracinement ? Ce n’est pas la tonalité retenue ici : « L’arbre n’est pas appelé à être déraciné, il est appelé à étendre ses racines vers le courant d’eau pour porter du fruit ; ce n’était pas un déracinement qui était proposé à Abraham, mais un élargissement » (p. 41). D’abord parce que, porté par la parole d’envoi « Va vers toi » ou « Va pour toi », selon la traduction d’André Chouraqui, le voyage se révèle être tout autant intérieur que géographique. La vertu mise en avant ici est le détachement, qui accompagne la perte. Cette perte des choses passées qui met à l’arrêt notre vie représente un défi pour la foi de celles et de ceux qui voient « diminuer et disparaître tant de choses », le défi de « découvrir le Dieu qui créé à partir de rien, qui appelle à la vie et nous entraîne dans un voyage nouveau et inconnu » (p. 56).
Les pièges de l’âge (chap. 4) seraient de renoncer à perdre, et donc de renoncer à avancer, en s’enfermant dans le passé. Ce que l’auteur appelle le « piège du rétroviseur », une métaphore qui fait comprendre l’enjeu de la « conduite » des séniors. Pour se garder d’une vie bloquée dans la nostalgie, les regrets ou l’amertume, seule l’espérance trace une voie de vérité, en ce qu’elle permet de faire face à la réalité et qu’en visant loin, elle ne cherche ni à rassurer, ni à faire montre d’un optimisme convenu et répandu notamment sous des slogans apparemment sympathiques : « Restez jeunes » « Soyez dynamiques », etc. Au contraire, portée par une foi attachée à ce que l’on ne voit pas, l’invitation faite aux séniors consiste à « croire que ce que je lâche pour Dieu n’est jamais perdu » (p. 58).
Aussi l’auteur achève-t-il sa réflexion en s’interrogeant sur le caractère remarquable de ce vieux tronc vivifié par les multiples greffes. Les véritables exploits des séniors ne sauraient se résumer à des performances sportives, ni aux palmes décernées pour record de longévité. Une approche croyante et édifiante de cet âge repose bien plus sur une compréhension renouvelée de l’amour. Un amour riche d’expérience, plus désintéressé et dont la promesse particulière peut s’exprimer dans une réciprocité vivifiante entre générations, en tout premier lieu entre grands-parents et petits-enfants. Dans une société où la performance est reine, toute promesse semble perdre en crédibilité quand elle ne s’inscrit plus dans cet état d’esprit. L’amour quant à lui promet de s’affiner encore dans les situations de faiblesse car « pour aimer vraiment, il faut abandonner tout ce qui est de l’ordre de la force, de la rapidité, des décisions fracassantes. Il faut entrer dans la faiblesse » (p. 104). S’il est une puissance dont dispose le sénior, ce ne peut être que celle de l’amour. Celle-ci sera à l’image de la réponse du vigneron au maître qui voulait faire couper le figuier stérile (Luc 13,6-9) : disposer du temps, creuser en intériorité, et apporter un terreau nourrissant, enrichi par les ans.
Un ouvrage stimulant sur une question sociétale de premier plan, que l’auteur aborde sous un angle général, ne cherchant pas à entrer dans des problématiques plus détaillées. Je pense aux dynamiques familiales portées par les séniors, dont nous savons qu’ils se situent bien souvent à l’articulation de deux générations à soutenir : les plus jeunes en devenir, et les plus âgés dont la dépendance grandit. Je pense encore au rôle des séniors dans les Églises, où ils jouent un rôle essentiel par leur plus grande disponibilité et par l’expérience qu’ils ont acquise. Si ces aspects restent manquants, l’approche proposée par Charles Kouyoumdjian convainc toutefois par la pertinence de son sujet et par les pistes de réflexion qu’elle suscite.
Julien N. Petit
Frédéric Worms, La vie, qu’est-ce que ça change ?, Genève, Labor et Fides, 2024, 101 pages.
Le titre un peu étrange de cet opus stimulant d’une centaine de pages s’explique par la collection à laquelle il appartient. Une collection inaugurée en 2024 à l’occasion du siècle d’existence de la maison d’édition théologique suisse, avec laquelle elle introduit dans son catalogue au caractère très scientifique des livres accessibles, appétissants, qui vont à l’essentiel.
Que faire de la vie ? La question est aussi évidente qu’abyssale et s’offrir de la traiter dans un format réduit relève d’une mission presque impossible. Il faut tout de suite la préciser : Que faire philosophiquement de la vie ? Quel genre d’objet, quelle matière à penser constitue cette vie dans et par laquelle nous nous mouvons, nous respirons et… nous mourons. C’est bien le vitalisme qui est le sujet de ce livre, autrement dit d’une pensée qui prend la vie au sérieux, qui retourne à son évidence sans la réduire à une idée, sonnant le glas d’une pensée cartésienne qui l’avait réduite à un décor suspect. L’auteur s’inscrit dans la lignée des philosophes de la vie, au premier rang desquels Schopenhauer, Nietzsche et Bergson. Frédéric Worms est spécialiste de ce dernier, dont il réédite les œuvres complètes aux Presses Universitaires de France.
« Qu’est-ce que la vie ? » : comme le biologiste Bichat l’avait formulé à la fin du XVIIIe siècle, la vie ne peut se connaître qu’à partir de son contraire, la mort, à laquelle elle s’oppose irrémédiablement : « L’évidence de la vie […] ne réside pas dans la représentation abstraite de la mort, mais dans l’opposition concrète à la mort. Tel est le principe premier » (p. 9). Cette affirmation n’est pas seulement la thèse de départ de l’ouvrage, car cela ne suffirait pas à fonder un vitalisme crédible. La proposition consiste ici à maintenir l’opposition au point de l’ériger en principe critique, à l’accueillir comme critère de la pensée, au même titre que pourrait l’être la raison.
Il en va pour l’auteur de la capacité de la philosophie à penser le monde contemporain. Notre moment est « le moment du vivant ». Le fait qu’en ce début de XXIe siècle la vie soit menacée développe une conscience aiguë de sa fragilité, mais conduit aussi à penser le vivant, ce que la tradition occidentale a réalisé selon deux approches différentes : la science objective et les théories spiritualistes. Se proposant en 3e voie, le plaidoyer vitaliste de Worms dessine une direction singulière. Il est important de préciser que l’auteur l’avait déjà exposée dans de précédents ouvrages, notamment Pour un humanisme vital (2019). Elle est présentée ici de manière plus succincte, sous l’appellation de « vitalisme critique ». L’opposition originaire relevée ci-dessus y prend une tournure décisive. Car la vie ne peut être définie, pas plus que le vivant, bien que ces deux notions soient particulièrement prisées aujourd’hui. Par conséquent, seuls existent des vies et des vivants singuliers, afin que la pensée puisse rendre compte de la complexité du réel : « La vie est une évidence, mais une évidence qui très vite se complique. Car les hommes ont mille façons de mourir et de se contredire » (p. 23).
Quelles sont les conséquences éthiques de ce recours à une version critique du vitalisme ? La première tient à un changement de son orientation : ainsi régulée, l’éthique ne se pose plus la question du bien et du mal, mais celle du meilleur et du pire. Le retour à l’évidence de la vie, ou, plus encore, de vies particulières semble exiger une telle relativisation, dès lors que l’on ne veut pas s’abstraire, ou s’extraire de la vie. La deuxième conséquence donne lieu à de longs développements autour du concept de violation, un concept que l’auteur avait déjà défini dans le cadre de ses travaux sur le soin (cf. Le moment du soin. À quoi tenons-nous ?, Paris, Odile Jacob, 2010), qui reste un axe important de ses recherches. La violation se comprend comme le pendant de la guerre. Quand celle-ci représente un danger ultime par la menace vitale qu’elle fait peser, celle-là représente un « danger intérieur ou intime » (p. 54). Ainsi la violation est la « destruction d’une relation vitale de l’intérieur même de cette relation » (p. 62). Compté au rang des enjeux pratiques du vitalisme, ce concept se décline sur un plan politique, dans la mesure où, aux yeux de l’auteur, les institutions démocratiques instituent en lois et en principes la lutte contre les violations. Deux exemples sont convoqués, étrangement sans qu’aucune contradiction pourtant légitime entre les deux ne soit mentionnée : l’abolition de la peine de mort « première institution réelle de l’humanité » (p. 82), et la pratique de l’Interruption Volontaire de Grossesse. Cette dimension institutionnelle du vitalisme lui donne une longueur de temps qui l’élève au-dessus de la réponse aux menaces pressantes. Mais la lutte de la vie contre la mort se réalise encore là, dans le dépassement de l’urgence. Elle s’éclaire alors autrement : de négation de la mort, elle devient prévention, et même affirmation par laquelle la vie se déploie elle-même. L’ouvrage se termine ainsi opportunément sur quelques belles pages sur la joie : « Car être en vie, c’est aussi avoir envie d’être en vie, et avoir envie d’être en vie passe par le plaisir, et même la joie » (p. 89).
Il me semble que la réflexion proposée, sans être directement théologique, ouvre cependant à de fortes résonances.
En premier lieu, il faudrait souligner la pertinence biblique du sujet traité : « Choisis la vie », « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et la vie en abondance », « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces seules citations suffiraient à le montrer, auxquelles on pourrait ajouter la qualification de Dieu comme « le Vivant ». La résurrection n’est-elle pas l’illustration par excellence d’une lutte engagée par l’Éternel contre la mort ?
Ensuite, le recul pris avec un vitalisme strict, fondé sur la notion englobante de « vie » ou de « vivant » constitue une piste intéressante et sérieuse, tant il n’est pas rare que celle-ci tende à devenir un critère ultime d’appréciation de l’éthique, définissant comme bon ce qui est « vivifiant » et comme mauvais ce qui est « mortifère ». La vie ne prend-elle pas par moments la place de Dieu en tant que critère décisif de l’éthique ? Si l’opposition vie-mort demeure chez Worms, du moins est-elle passée au tamis d’une certaine complexité.
Un troisième aspect mérite attention, quand l’auteur souligne la dimension relationnelle de la vie et la mise en avant de l’intériorité dans l’existence. On y verra une précieuse ouverture sur le chemin d’une saine spiritualité, qui n’oublie ni Dieu, ni le prochain.
Julien N. Petit
Glenna Marshall, Mémoriser l’Écriture. Acquérir les bases et découvrir les bénédictions de la Bible (traduit de l’anglais par Antoine Doriath), Pontault-Combault, Éditions Farel, 2024, 145 pages.
Avec le nombre de manuscrits qui ont permis la pérennité de ses textes et par l’ampleur de sa diffusion, la Bible représente l’écrit par excellence. Au temps de la Réformation, dont on oublie parfois qu’elle correspondit à une révolution technologique avec le développement de l’imprimerie et la fabrication des livres, les élèves apprenaient à lire dans ses pages. Aujourd’hui, alors que nous vivons une nouvelle révolution technologique, numérique celle-là, nous disposons de la Bible sur ce support multitâches de notre quotidien qu’est le smartphone. En deux ou trois clics, le livre des Proverbes ou l’Épître aux Romains s’ouvrent et s’offrent à notre lecture. Ils peuvent même être entendus grâce à une voix de synthèse. Il n’a jamais été aussi facile d’accéder au texte de l’Écriture.
La proposition que fait l’autrice dans ce livre avance donc à contre-courant de ces facilités. Sans aucun passéisme, ni regret du « monde d’avant », elle s’inscrit dans ce qui a été tout aussi déterminant pour le christianisme : la transmission orale. Aussi se demande-t-elle avec bienveillance si l’omniprésence des moyens d’accès au texte biblique sous tous ses formats ne correspond pas paradoxalement avec une certaine méconnaissance de l’Écriture. Par connaissance, Glenna Marshall n’entend pas une approche des textes par l’étude. Conformément au titre programmatique de son ouvrage, elle s’intéresse à la mémorisation des textes, suivant le double angle de sa finalité et de sa mise en œuvre pratique. Les lecteurs ne trouveront pas ici de formulations théologiques originales, innovantes, offrant des perspectives radicalement nouvelles sur le monde. Là n’est pas l’ambition de l’autrice, dont le témoignage vise plutôt l’encouragement des chrétiens à mieux connaître Dieu en gardant le plus possible à l’esprit sa Parole par un apprentissage par cœur. Réussissant à créer une connivence avec le lecteur par les différents récits tirés de son expérience de vie et par les leçons d’une pratique éprouvée au long de nombreuses années, elle plaide en faveur d’un attachement renouvelé à la sagesse divine par le biais de la mémoire. Elle voit ainsi dans la mémorisation des textes une action plus profondément transformatrice que l’étude. C’est ainsi que le premier chapitre de la Lettre aux Colossiens a été déterminant pour elle, à une période où sa santé était éprouvée : « Si j’avais simplement étudié ce passage un jour ou deux, j’aurais été encouragée et édifiée, mais le creuser en profondeur […] pour graver les paroles dans mon esprit en les répétant souvent à voix haute, tout ce travail de mémorisation a consolidé dans mon cœur ces vérités réconfortantes concernant Jésus » (pp. 64-65).
Pourquoi apprendre par cœur des textes bibliques comme ce chapitre, ou encore le Psaume 145 ? Pour mieux connaître Dieu à travers la révélation spécifique de l’Écriture. Plus largement, si les chrétiens veulent ancrer leur existence dans la méditation de la parole de Dieu, il est bon qu’ils la mémorisent afin que ses richesses ne se trouvent jamais loin de leur esprit. Quand ils connaîtront des temps de tentation, ou de tempête intérieure, elle sera leur boussole. Et quand tous les voyants seront au vert, elle maintiendra vivants ses encouragements. Car la mémorisation vise principalement la méditation, ce que d’autres appellent encore « rumination » de la Parole.
Au fil des 9 chapitres du livre, nous passons du « Pourquoi ? » au « Comment ? », dans une approche pragmatique. Toujours encourageante, l’autrice confesse à plusieurs reprises qu’elle n’est pas une surdouée de la mémoire, et que, par conséquent, l’exercice reste à la portée de tous. Mémoriser l’Écriture peut s’insérer dans le quotidien, en investissant les « temps morts » des jours ordinaires, quand nous faisons la queue à une caisse, ou que nous patientons en salle d’attente ; les temps d’activité pendant lesquels notre cerveau reste disponible, par exemple en faisant la vaisselle. Pas de méthode révolutionnaire, donc, mais une imprégnation patiente intégrée au rythme de vie et à la disponibilité de chacun.
Petite clef mise quand même à la disposition des lecteurs : la mémorisation via l’écriture abrégée des versets par la première lettre de chaque mot, une technique évoquée à plusieurs reprises, dont il n’est malheureusement pas donné d’exemple pratique. En revanche, chaque chapitre se termine par des propositions de textes fondamentaux à apprendre sur la thématique traitée, avec les mentions d’une version longue et d’une version courte pour chacun.
Nul doute que ce livre accessible à un large public dispense d’utiles encouragements, en réponse au verset du Deutéronome : « Ces paroles que j’institue pour toi aujourd’hui seront sur ton cœur » (Dt 6,6). On se demande par moments s’il n’y a pas dans cette focalisation sur la mémorisation un brin de solution miracle, mais on ne peut en définitive qu’acquiescer à la proposition, dans ce qu’elle dit de notre attachement à l’Écriture comme parole vivante de Dieu. À l’heure où l’on commence à prendre conscience des méfaits psychiques de la fréquentation assidue des réseaux sociaux, nous découvrons là une alternative crédible, et spirituellement édifiante. Il est permis de se demander si par cette pratique d’une simplicité exemplaire, que les pédagogies n’ont cessé de reléguer à l’arrière-garde, ne pourrait pas donner une impulsion à un renouveau de fréquentation de l’Écriture dans les Églises.
Julien N. Petit
Éric Fuchs, Fenêtres sur l’invisible. Anthologie éthique et théologique, Genève, Labor et Fides, 2024, 311 pages.
Le théologien Éric Fuchs, décédé en 2023, laisse une œuvre éthique importante, remarquable par la diversité des sujets abordés, et par sa capacité à entrer en dialogue avec les questions d’actualité. Cette anthologie publiée à titre posthume, sous la direction de sa fille Catherine Fuchs et du professeur Michel Grandjean, veut lui rendre hommage par un choix de textes représentatifs de cette œuvre, tout en caressant l’ambition de donner envie à des lecteurs non avertis de lire ou de relire leur auteur. Éric Fuchs avait lui-même constitué un premier ouvrage de textes choisis en 2000, sous le titre L’exigence et le don. Pour cette anthologie posthume, la volonté est d’ouvrir le spectre en faisant figurer, à côté de textes significatifs puisés dans les ouvrages majeurs, des articles publiés dans des revues plus confidentielles. Les 9 chapitres présentés abordent cependant les principales thématiques traitées par l’auteur, dont on rappelle qu’il fut directeur du Centre Protestant d’études de Genève, puis professeur dans les universités de Lausanne et de Genève. L’éthique protestante, la sécularisation, la sexualité, la politique, l’art, l’éthique médicale : voilà qui donne un aperçu de leur étendue.
L’éthique, nous le savons, est devenue un point névralgique pour les Églises dont l’autorité doctrinale s’est affaissée dans la société. Si elles sont attendues désormais, si leur parole peut encore avoir aux yeux du plus grand nombre une forme de légitimité, c’est là qu’on veut bien les entendre, à ce carrefour citoyen où se construisent des échelles de valeurs. Ce constat, Éric Fuchs s’est refusé de le fuir. Penser l’éthique théologique dans le contexte de la sécularisation lui est apparu comme une exigence fondamentale pour les Églises protestantes. Deux articles de cette anthologie se penchent sur la question, cherchant toujours à l’éclairer en se tenant à distance d’un catastrophisme de principe et d’une opposition systématique à la modernité. Fuchs fait sienne, à la suite notamment de Max Weber, l’affirmation de l’origine chrétienne de la sécularisation, permettant d’entrevoir l’Évangile comme clé de ce phénomène qui touche les sociétés occidentales. Le christianisme, avance-t-il, est renvoyé à « ce qui est proprement son essence, à savoir la reconnaissance de l’absolu que représente tout être humain en vertu de l’amour que Dieu lui offre » (p. 73). Apparaît ici une notion centrale de cette réflexion éthique : la reconnaissance qui, avec la responsabilité, forment les deux colonnes de l’éthique protestante. De sorte que s’il existe un « sérieux éthique » attribué aux protestants, celui-ci naît d’abord « d’un souci de se montrer dignes de l’appel reçu » (p. 86). Mettre en avant le mouvement de la reconnaissance implique de se référer pour sa vie à une autre source que soi-même, d’effectuer constamment un acte de remémoration et d’interprétation d’un événement fondateur extérieur à soi qui devient « dans le lien personnel de confiance, de foi » (p. 59) une réalité qui fait sens aujourd’hui. Ainsi Éric Fuchs a-t-il accepté, dans un texte de 1999, de se risquer à définir une nouvelle identité chrétienne : « rappeler qui est le Christ », « parier sur la vérité de sa parole », compter sur « le langage fragile et multiple des témoins » (p. 134), tels en sont les voies, aussi risquées que solides, qui en appellent à une certaine modestie conceptuelle. À la différence du catholicisme, le protestantisme ne peut compter sur le poids indéfectible d’une tradition dans l’élaboration de sa théologie. Au contraire, il est piégé dans le complexe de la tabula rasa, très puissant en son sein, qui veut que « le travail théologique ne procède […] que par ruptures et jamais par filiation ou continuités. Chaque génération réinvente la théologie en renvoyant au néant, ou presque, les travaux des récents prédécesseurs » (p. 179). Serait-ce le constat de la modernité un peu folle d’un protestantisme cherchant à s’accorder avec l’aspiration sans fin à la nouveauté, à l’originalité et à l’oubli tant prisée à l’aube de ce millénaire ? Loin de s’y résigner, l’éthicien plaide en sens contraire, soulignant non seulement la centralité de la Bible, mais le caractère contestataire de ces textes, « leur mouvement, leur richesse symbolique, leur capacité d’interpellation, leur non-conformisme créateur » (pp. 56-57) appelant à un travail herméneutique renouvelé contre la domination du fast-food culturel et sans l’orgueil facile du dernier arrivé. Dans des pages inspirées, Fuchs livre un plaidoyer pour la Bible, dont les Églises issues de la Réforme ont été « depuis quatre cent cinquante ans […] les protectrices et les servantes » (p. 186). On se souviendra que le professeur d’éthique avait tout d’abord été bibliste.
Des lecteurs et lectrices avertis reconnaîtront sa voix – réformée – aussi dans la définition de la Loi biblique comme lieu d’altérité, avec des accents de type psychanalytiques ; altérité encore en matière d’éthique sexuelle, abordée ici à travers deux articles explorant la valeur spirituelle de l’érotisme et de l’intimité. Altérité de Dieu, enfin, dont la paternité est défendue comme marqueur de l’identité chrétienne, à distance des accusations de machisme ou d’encore de paternalisme. Dire un Dieu Père pour Éric Fuchs, c’est confesser d’abord notre absence de maîtrise de la vie ; c’est encore faire le constat que nous ne pouvons nous enfanter nous-mêmes. Ce que nous sommes, nous le devons à une certaine compréhension de Dieu, comme au mystère de la vie qui nous entoure, sur lequel, au-delà des discours, « l’amour, l’art, la foi […] ouvrent une fenêtre » (p. 304).
Une esthétique trouve donc aussi sa place dans le florilège qui nous est proposé, pour faire droit à une médiation qu’appréciait et connaissait l’auteur : la peinture, ce domaine du visible renvoyant presque toujours à l’invisible, de même que la musique ne saurait se passer de silence. Si invisible il y a, alors la foi ne peut faire l’économie du doute, qui n’est pas son contraire, mais son « complice, l’ami exigeant qui ne s’en laisse pas conter » (p. 301). Un doute qu’il faut donc approcher, apprivoiser peut-être, sans pour autant lui céder la place.
Au terme de cette lecture, nous nous dirons peut-être que des sujets manquent à l’appel : l’argent, la technique, dont la puissance exige de nous que nous leur répondions par une attitude morale. Les champs labourés par Éric Fuchs sont cependant déjà larges.
En revanche, même si cette anthologie ne vise à aucune exhaustivité, il est étonnant de ne pas voir mentionner l’ouvrage qui restera comme le dernier de l’éthicien, et qui a fait grand bruit lors de sa parution en 2011 : Turbulences, co-écrit avec Pierre Glardon sur la crise des Églises réformées. Il semble avoir été oublié de la liste des ouvrages collaboratifs cités dans l’avant-propos. C’est dommage, car les positions qu’il y défendait étaient courageuses. Un courage qui est en dernier lieu le signe d’une saine éthique. Tout comme le désir, valorisé dans une formule que je laisse ici en point d’orgue : « Mendiants d’espérance, nous ne sommes riches que de notre désir » (p. 134).
Julien N. Petit